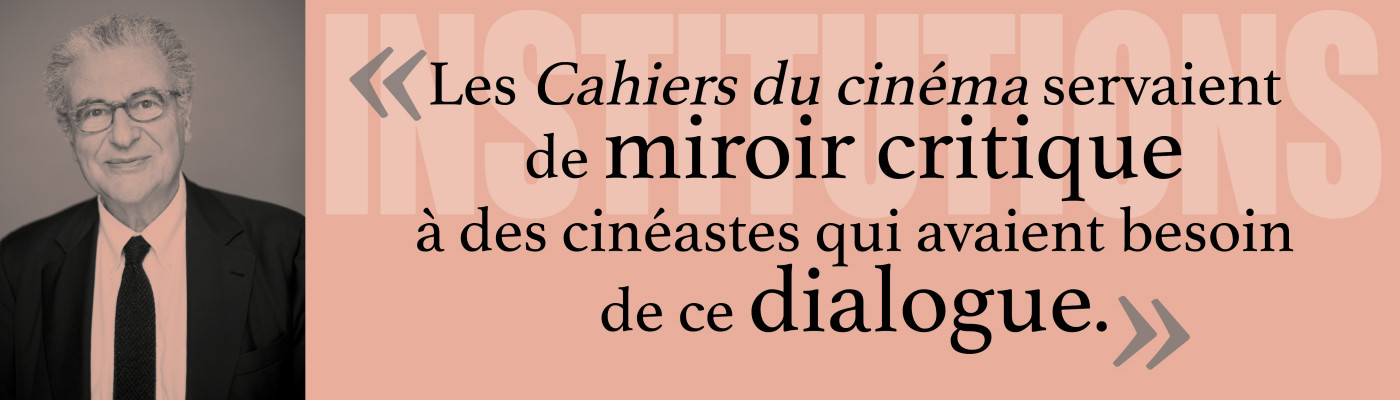SERGE TOUBIANA
Président d’Unifrance (France)
If you wish to read this article in english, please follow this link.
« Si une revue sert à quelque chose, c’est entre autres à nouer un dialogue avec les cinéastes. Durant les 25 ans qu’a duré ma vie de critique aux Cahiers du cinéma, il m’est arrivé de défendre des films que je ne défendrais peut-être plus aujourd’hui. Mais, sur la durée, le risque d’être trop généreux m’apparaît moins grave que celui d’avoir été trop sévère ou injuste. Car, là on se dit qu’on est passé à côté de quelque chose, ou qu’on a fait du mal ou du tort à un film ou à quelqu’un. Je regrette par exemple d’être passé à côté de Claude Sautet, perdant ainsi une occasion de dialoguer avec ce cinéaste dont j’ai réévalué l’œuvre.
Il y a eu à un moment, peut-être un âge d’or des Cahiers, où il y avait cette idée que la revue servait de miroir critique à des cinéastes – des auteurs - qui avaient besoin de ce dialogue qui passait par de longs entretiens, un dialogue sous-jacent qui accompagnait la continuation de leur œuvre. Il y a eu aussi un moment dans l’histoire de la revue où ce dialogue s’est rompu : les années idéologiques allant de 1970 à 1975, voire plus.
Jean Eustache, pour qui j’avais une grande admiration, m’a dit un jour : "Quand j’ai eu besoin de vous, les Cahiers, vous n’étiez pas là !" Il avait raison. Il voulait parler de la période de La Maman et la putain, quand son film était sorti, provoquant un véritable combat critique. En effet, nous n’étions pas à ses côtés. C’était en 1973, la revue se traînait encore dans l’ornière maoïste, si bien que la critique du film s’était limitée à un article de Pascal Bonitzer, qui prenait en considération dans son texte trois films : La Maman et la putain, La Grande bouffe et Le Dernier tango à Paris. Pascal avait écrit un texte brillant et lacanien, mais le seul fait de traiter ces trois films ensemble revenait à les minimiser, alors que c’était à l’évidence des œuvres importantes et que La Maman et la putain, l’un des plus grands films du cinéma français, aurait mérité d’être sérieusement pris en compte. Il me paraît évident qu’il aurait fallu qu’il y ait un article distinct sur chacun de ces films, accompagné d’un entretien avec leur auteur. Mais nous étions alors assez désinvoltes, enfermés dans notre bulle idéologique et dépourvus de la moindre lucidité critique. Notre regard était comme voilé, obstrué par le primat idéologique. Quand il a découvert cet article dans les Cahiers, une revue dont il se sentait proche, comme si elle était sa propre famille, car il y avait si souvent traîné étant jeune, Eustache a compris que nous n’étions pas au rendez-vous de son film.
À la même époque, Truffaut était lui aussi affecté du fait que les Cahiers, sa revue, ne prenaient plus la peine de rendre compte de ses films. Si vous regardez les Cahiers du cinéma du début des années 1970, vous constaterez que des films comme L’Enfant sauvage ou Les Deux Anglaises et le Continent ne sont même pas rubriqués ou critiqués. Il n’y a rien. Or ce sont des films auxquels il tenait énormément, des moments essentiels de son œuvre. Pour les Cahiers de l’époque, ils n’étaient pas intéressants sur le plan formel, encore moins sur le plan idéologique. C’était l’époque de la sémiologie et de la psychanalyse, de l’influence structuraliste - Christian Metz, Barthes, Lacan, etc. Si bien que le cinéma de Truffaut n’entrait plus dans les radars. Que cela l’ait affecté était la moindre des choses. D’autant plus qu’en 1969, il avait contribué à sauver la revue en faisant en sorte, avec Jacques Doniol-Valcroze et des amis proches, de la racheter à Daniel Filipacchi qui en était le propriétaire. Grâce à Truffaut et Doniol-Valcroze, grâce à Claude Berri, Costa-Gavras, Michel Piccoli, Nicole Stéphane, Pierre Braunberger, Jean Riboud, autant de personnes amies de Truffaut, une somme d’argent avait été collectée pour permettre à la rédaction de retrouver son indépendance. Donc, ceux-là mêmes qui avaient retrouvé une indépendance rédactionnelle, octroyée par ce groupe d’amis, ont considéré que l’œuvre en cours de Truffaut ne méritait pas d’être considérée sous un angle critique dans les pages de la revue. C’était Godard contre Truffaut. Donc, exit Truffaut des pages de la revue. Dès lors, les Cahiers n’étaient plus cet outil critique et réflexif au service des cinéastes, qui est pour moi leur véritable vocation.
Bien plus tard, en 1980, j’ai voulu que l’on aille rencontrer Truffaut, qui a accepté de nous recevoir – il terminait le montage du Dernier métro. Avec Serge Daney et Jean Narboni, nous avons passé une journée entière chez lui à faire un très long entretien, dense, clairvoyant et passionnant, parfois polémique lorsqu’il réglait enfin ses comptes avec Godard. Cet entretien était si long qu’il fut publié sur deux numéros à la suite. Ce fut pour moi une date importante : les Cahiers renouaient un dialogue avec Truffaut, qui s’était interrompu bien avant que je ne sois critique de cinéma. Par la suite nous avons renoué un même dialogue avec Rohmer, Chabrol ou Rivette, mais également Pialat, Téchiné, Jacquot, Doillon, et beaucoup d’autres auteurs importants, en sentant que cela comptait aussi pour eux. Pas spécialement parce qu’ils voulaient que l’on dise du bien de leurs films, mais parce qu’ils ressentaient le besoin de ce dialogue avec la critique, en particulier avec les Cahiers.
Lorsque Serge Daney a pris la responsabilité des Cahiers du cinéma en 1974, j’étais en quelque sorte son second, la revue était cliniquement morte. En termes d’abonnements, de lectorat, nous étions au plus bas de l’histoire de cette revue. J’avais un peu une position d’apprenti, Serge reprenait de manière souveraine la revue en lui réinsufflant le plaisir du cinéma, le plaisir du voyage, le plaisir de rencontrer des cinéastes, d’où qu’ils viennent. Comme je m’occupais davantage que lui de l’administration, j’ai rapidement commencé à voir que, de mois en mois, les abonnements et les ventes augmentaient : un nouveau cycle redémarrait, lentement.
Nous avions replacé au centre de notre démarche un principe de plaisir, que nous pouvions exercer en toute quiétude parce que nous n’avions pas la pression de l’industrie. Et, dans les meilleures périodes, nous avons pu avoir le sentiment de vivre un collectif en acte, d’élaborer ensemble un point de vue de critique. De cela, j’ai beaucoup profité et beaucoup appris. Serge a pu ressentir ce fonctionnement collectif comme assez étouffant. Quand il est parti à Libération, en 1981, ça a été pour lui, sans jeu de mots, une vraie libération. Le fait pour lui d’écrire des articles à paraître le lendemain, d’être lu par un bien plus grand nombre de lecteurs et d’avoir pour ainsi dire un feedback immédiat, le changeait de ce rythme bizarre qui est celui d’un mensuel où vous investissez autant (si ce n’est plus) d’énergie, mais où la lenteur du processus fait que le retour est très hypothétique. En écrivant dans un quotidien, c’était comme s’il jouait au tennis avec ses lecteurs : il envoyait la balle, le retour venait tout de suite et cela le comblait narcissiquement.
J’ai pris sa succession aux Cahiers, en essayant de poursuivre mais à ma manière, un peu différemment, ce principe de plaisir, de curiosité et d’ouverture critique. Avec des rédacteurs comme Alain Bergala, Charles Tesson, Olivier Assayas, Alain Philippon, Serge Le Péron, Danièle Dubroux, et d’autres. En 1982 : les deux numéros de Made in USA ont eu un énorme succès, il faut dire que nous avions magistralement renoué avec le cinéma américain après des années de disette. Made in Hong Kong, que Charles et Olivier ont totalement conçu ensemble en 1984, est un numéro qui n’avait pas du tout marché à l’époque, mais qui est devenu un collector, du fait qu’ils avaient rencontré absolument tout le monde et pointé à peu près toutes les perspectives qui s’ouvraient du côté du cinéma asiatique à ce moment-là (autrement dit, tout ce qui allait se passer dans les 15 ou 20 années suivantes). Là, j’ai beaucoup aimé travailler aux Cahiers. Quand nous étions dans cette perspective de défrichage, cette démarche de pari, cette volonté d’être à l’affut, de voir avant tout le monde ce qui allait naître, d’être en état de curiosité critique… Quand c’est possible, c’est là qu’est le plaisir : non pas être à l’initiative des œuvres, mais être parmi ceux qui les découvrent et qui les mettent en perspective, pour nos lecteurs et peut-être aussi pour les autres critiques. A un moment, les Cahiers ont pu avoir cette influence-là.
À 50 ans, j’étais épuisé et j’avais un peu fait le tour des joies de la rédaction en chef des Cahiers du cinéma. J’ai adoré le faire et puis j’ai moins aimé le faire. Je l’ai bien fait à une époque, je l’ai moins bien fait à une autre. Je me sentais émoussé. Et puis je connaissais trop les cinéastes, les artistes, les producteurs… J’avais trop de relations d’amitié avec des cinéastes, et mon regard critique n’était plus aussi libre, souverain. Je me suis dit qu’il fallait passer à autre chose. Et c’est ainsi que s’est terminée ma vie de critique.
Aujourd’hui, en tant que président d’Unifrance, je découvre un autre pan du cinéma : celui de l’exportation. Ma mission consiste dans le fait d’accompagner le cinéma français à l’étranger, et je me rends compte à quel point cette problématique nous était totalement étrangère lorsque j’étais critique de cinéma aux Cahiers. À aucun moment ça n’a été un souci, une préoccupation, une curiosité, de savoir si tel film français se vendait à l’étranger ou connaissait une belle carrière internationale. Aujourd’hui, je suis très conscient du fait que c’est fondamental. Pour prendre un exemple, je connais Mia Hansen-Love depuis plus de vingt ans, j’ai suivi tout son parcours, mais pour autant je ne mesurais pas à quel point son travail est pris en compte à l’étranger. C’est la même chose pour Claire Denis. Peut-être plus encore que dans leur propre pays, ces cinéastes bénéficient d’une réputation, d’une sorte d’aura critique, de l’intérêt des distributeurs américains et asiatiques, des festivals internationaux… Je réalise aujourd’hui que cette notoriété à l’étranger est susceptible de leur apporter plus de liberté. Tout simplement parce que quand Mia Hansen-Love fait un film, il est pré-vendu en Allemagne, dans les pays nordiques, il y a tout de suite un acheteur japonais, coréen ou nord-américain qui s’y intéresse...
Dans l’économie globale qui régit la circulation des films, la critique a un rôle qui n’est pas immense mais qui a une importance symbolique. C’est-à-dire que si la critique, ou du moins une partie de la critique, porte son attention sur un film, sur tel ou tel cinéaste, c’est nécessairement une valeur ajoutée qui favorise potentiellement l’éclosion de telle ou telle œuvre sur les marchés étrangers. Mais il y a aussi, et peut-être surtout, des microcosmes où se font en partie la carrière des films européens sur le marché américain. Le festival de Telluride, par exemple, jouit d’un grand prestige, c’est un lieu très chic où toute la communauté indépendante américaine se retrouve, le premier week-end de septembre, dans cette toute petite ville du Colorado, et pousse les films vers les Oscar. C’est également vrai pour Toronto, à une échelle plus industrielle. C’est un festival public et non compétitif, où le seul fait d’être sélectionné vous donne une chance de trouver un distributeur américain. A Toronto les salles sont toujours pleines, c’est un bon indicateur quant à ce que votre film peut espérer obtenir sur le marché Nord-américain. Il y a aussi bien sûr Berlin, Venise, San Sébastian… Et Cannes, évidemment, le plus important d’entre tous. Mais il faut également mentionner le Festival de New York. Des années 1970 jusqu’à sa mort, Truffaut y était très régulièrement sélectionné, et sa carrière américaine reposait en grande partie là-dessus. C’est-à-dire que si un ou plusieurs grands festivals vous est fidèle, votre notoriété d’artiste s’installe peu à peu. Et la critique prend le relai naturellement, ensuite les distributeurs indépendants font leur travail. En résumé, il y a toute une chaîne économique et symbolique dans laquelle la critique a évidemment un rôle majeur : celui de déclencher du désir. Et elle a comme relai naturel les festivals et les distributeurs indépendants. »

Propos recueillis par Nicolas Marcadé